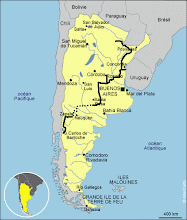LA FAMILLE GONZALEZ
LA FAMILLE GONZALEZ Au réveil, Juan et Nelly nous offrent le fameux maté, boisson traditionnelle qui passe de main en main. Echange propice aux discussions, on parle surtout d’équitation et d’agriculture. Le cheval est tellement ancré dans la culture que même sur les portes des toilettes, on peut lire “damas” pour les dames, et “caballeros” qui veut dire cavalier pour les hommes.
Voyant le petit potager, nous les interrogeons sur leur production. “Il ne donne presque plus rien, se plaint Juan, c’est à cause des avions qui étendent des produits sur les champs des environs. Le vent ramène tout par là. Lorsqu’ils viennent de traiter, les poissons remontent morts à la surface de la lagune.” Et nous qui pensions manger de délicieux fruits et légumes en Argentine, ils y sont peut-être encore plus traités (le roundup est toujours utilisé sans modération) et cueillis encore verts. Pendant ce temps, un colibris qui mérite bien son surnom d’oiseau mouche, butine les énormes fleurs roses du jardin, innocemment.
Juan cherche une activité pour son après midi. Il finit par nous proposer de prendre les chevaux pour aller se balader tous les deux comme des grands. Je m’entraine à ne plus faire de “crêpes” au galop assit sur ma selle gaucho. clio profite de sa selle anglaise pour me rattraper avec un trop enlevé aérien lorsque son pépère fainéasse au pas. Nous savourons ce petit tour, nous imaginant déjà sur la route des Andes.
Au retour, nous nous arrêtons savourer une petite bière bien fraiche pour conclure cette balade. Negra, la propriétaire au joli bagou est de la famille de Sergio. Ce dernier nous convie d’ailleurs au match de foot local le soir-même.
Connaissant notre petite faiblesse, Nelly nous a préparé de délicieuses empenadas, tout comme le ferait une bonne grand-mère. Après quelques verres de vin et une tablée bien animée avec leurs enfants Monica et Martin, nous filons rejoindre Sergio.
Nous éclusons quelques pintes pendant que les ballons volent de tous les côtés. L’ambiance est bon enfant, la plupart des supporters entamment déjà la troisième mi-temps. Sergio et Monica nous embarquent ensuite au pub du bled où se retouve toute la fraterie. La bière Quilmes coule à flots et les rires fusent. Les Gonzalez nous tendent une embuscade pour que nous restions faire la fète vendredi soir, mais nous ne pourrions pas prendre le train en fin de semaine.
Difficile de se lever et de marcher sous le soleil jusqu´à la lagune pour ne pêcher qu’un seul et unique poisson, surtout en voyant les autres les attraper par dizaine ! Tant pis, nous le savourerons d’avantage !
La dernière soirée à Salvador Maria se passe entre polenta et photos souvenirs. Il est deja temps de quitter la chaleureuse hospitalité des Gonzalez, sur de grands sourires et de “Buena Suerte !” Nous profitons des derniers instants avec Monica et Sergio qui nous ramènent à lobos en voiture. La joie sur leur visage nous donne la force de traverser le pays. Tant mieux, nous en aurons besoin…

UNE HISTOIRE DE CHIEN
Petite expérience qui permet de connaitre les limites de notre optimisme…
Le retour à Buenos Aires se fait sans encombres, c’est la fuite de la ville qui sera plus difficile. Après avoir erré de gare en gare, nous apprenons que le train est annulé, et que de toute façon la ligne est coupée après Bahia Blanca suite à un glissement de terrain. Bien sûr les bus refusent de prendre les chiens à bord. Pour courronner le tout, il nous faudra plus d’une heure de négociations le lendemain, et ce après une journée d’attente pour finalement convaincre quelques responsables. Il n’y a pas de wagon à bagages pour les chiens, et mème si nous avions une cage ce ne serait pas possible. Le controleur refusant formellement, nous finissons par sauter par dessus les rails et monter en vitesse dans le train comme des clandestins. Une fois à l’intérieur, deux jeunes mécanos nous font passer en première classe où “il n’y a jamais personne” rigole Nicolas en fermant à clé derrière lui. Nous sympathisons avec eux, et Nicolas aura tôt fait de nous arranger les choses avec les controleurs. Changement à Bragado, même histoire de clandestin pour se faire discret. Notre bonne étoile revient, le nouveau controleur fermera les yeux. Petit signe ? Les mamas sur la banquette à côté nous révèlent que l’année dernière un voyageur est partit jusqu’aux Etats-Unis avec un cheval de Pehuajo. Peut-être allons nous trouver notre bonheur là-bas ?
La journée suivante est désastreuse. Nos illusions de voyager en stop s’estompent alors que nous séchont une après midi au soleil, en vain. Un coup de téléphone à l’estancia que nous essayons de rejoindre abrège nos souffrances: les chevaux ne sont pas à moins de dix mille pesos, une fortune !
Chez Mazola, même rengaine, pas de canassons en dessous de cinq mille pesos. Il finit par nous en dégoter deux à trois mille cinq cent pesos. “Ceux qui ne me servent pas, sans pédigré…” dit-il.
La séance d’achat est infructueuse mais enrichissante car la plus dans les règles que nous ayons faite. Le premier n’a pas de bons aplombs, transpirant trop pour le peu d’efforts fournis, et sa robe ne brille pas, signe de mauvais état général. L’autre a carrément au sabot abimé et le paturon gonflé, refusant de partir au galop. La recherche continue, mais il va falloir trouver un moyen de transport.
PROGRESSION LABORIEUSE
Nouvelle tentative de stop, qui échoue. La moutarde nous monte au nez. Même les routiers avec qui la conversation est engagée refusent de rendre ce service. Les gens sont trop méfiants et ont peur de se faire braquer. Nous finissons par rejoindre Santa-Rosa avec un remise, taxi longue distance, pour un peso du kilomètre. Alors que Daniel va pour nous déposer à Cachirulo, petit bled choisi au hasard sur la carte, un soupçon de hantise nous saisit. Que venons nous faire ici ? Il n’y a que trois maisons et des carcasses de voitures, le tout sans un cheval en vue. Le prochain village (le même ?) est à vingt kilomètres. Nous atterrissons finalement dans une station service pour s’acharner une nouvelle fois à jouer aux autostopeurs.
qui la conversation est engagée refusent de rendre ce service. Les gens sont trop méfiants et ont peur de se faire braquer. Nous finissons par rejoindre Santa-Rosa avec un remise, taxi longue distance, pour un peso du kilomètre. Alors que Daniel va pour nous déposer à Cachirulo, petit bled choisi au hasard sur la carte, un soupçon de hantise nous saisit. Que venons nous faire ici ? Il n’y a que trois maisons et des carcasses de voitures, le tout sans un cheval en vue. Le prochain village (le même ?) est à vingt kilomètres. Nous atterrissons finalement dans une station service pour s’acharner une nouvelle fois à jouer aux autostopeurs.
Alors que l’histoire et le désespoir se répètent, malheur à nous d’embaucher Alexandro, le gros lourdaud ! Non seulement le tarif négocié n’est pas celui attendu, mais en plus il est bête et conduit très mal. Nous n’avons qu’une envie, sortir de la voiture ! Nous devons d’abord aller à sa superette et faire cent kilomètres de détour. Croisant un haras, nous prétextons d’aller demander pour des chevaux. Le bonhomme nous donne une adresse à Maza, à vingt kilomètres du village d’Alexandro. Très bien, nous allons nous débrouiller pour y passer la nuit.
A la superette, l’ambiance se détend même si le simplet fait le compte des paquets de cigarettes que Rustine a bousillé pour tenter de sortir du coffre.
Chez Edouardo Fernandez, à Maza, nous sommes rasurés. Nous allons dormir par ici et dire au revoir à l’affreux jojo qui devait nous servir de taxi.
Alors que ce dernier nous a pompé toutes nos forces, c’est grincheux que nous découvrons enfin, des gens sympathiques et avenants. Les empenadas englouties ne suffiront pourtant pas à nous redonner le moral.
Aller à Maza nous a fait faire demi-tour, et cela rien que pour esquiver Alexandro. Les chevaux ne sont pas non plus à la hauteur de nos attentes. Trop jeunes, tros grands et trop gros, avec de mauvais aplombs, sans allant, bref les pires jusqu’à aujourd’hui. Même Edouardo se révèle un peu antipathique. Découragés, nous voici éloignés de notre route. L’avenir nous apparait comme obscur, mais nous avons décidé de ne plus nous arrêter avant Bariloche, à l’autre bout du pays.
EN ROUTE POUR LA CORDILLIERE
 La petite famille de la rotisserie nous a redonné le sourire. Au grincement de la porte, tout le monde se précipite pour venir discuter. Les petites filles à l’oeil malicieux font mine d’être timides. Le plus grand a un débit verbal important, tout comme la mère. “Abuela !” crie une petite. Et la grand-mère sort de ses fourneaux, nous offre un gateau, la banane jusqu’aux oreilles. A chaque passage, nous nous régalons de les entendre parler.
La petite famille de la rotisserie nous a redonné le sourire. Au grincement de la porte, tout le monde se précipite pour venir discuter. Les petites filles à l’oeil malicieux font mine d’être timides. Le plus grand a un débit verbal important, tout comme la mère. “Abuela !” crie une petite. Et la grand-mère sort de ses fourneaux, nous offre un gateau, la banane jusqu’aux oreilles. A chaque passage, nous nous régalons de les entendre parler.
Pour se rendre à Viedma, nous faisons affaire avec des jeunes tout autant gentils. Alexandro, Barbey et Abigaël font passer la pillule d’un voyage plus onéreux que prévu. La route n’est que rires, bonne humeur et maté ! Ils travaillent tous deux en discothèque pour vingt pesos la nuit, soit quatre euros. A côté, elle fait baby-sitter pour trois cent pesos le mois, et lui taxi, ce qui marche plutôt bien. En faisant une rapide comparaison, leur niveau de vie est très faible. Les voitures sont plus chères qu’en France, et bien d’autres choses comme le gasoil ou la nourriture ne le sont pas beaucoup moins. A l’arrivée, grands aux revoirs et ambrassades. Ils ne veulent même pas de notre pourboire. Nous devons insister car ils ne seront pas rentrés avant cinq heure du matin, pour ensuite travailler à six heure et après mille deux cent kilomètres.
 A Viedma, nous cherchons un coin tranquille pour dormir. Après avoir vu à l’entrée de la ville un jeune se trimballer l’air de rien avec une carabine, il nous semble judicieux de bien réfléchir où planter la tente… Ce sera donc derrière une station service où le rompiste nous accueille gentiment.
A Viedma, nous cherchons un coin tranquille pour dormir. Après avoir vu à l’entrée de la ville un jeune se trimballer l’air de rien avec une carabine, il nous semble judicieux de bien réfléchir où planter la tente… Ce sera donc derrière une station service où le rompiste nous accueille gentiment.
Cette fois-ci, les chiens ne poserons pas de problème pour prendre le train, même si leur place dans le wagon à bagages est plus chère que la nôtre.
Le Trans-Patagonien se met lentement en route. Autour de nous, un nombre impressionnant de mioches braillent et gesticulent dans tous les sens. Les voyageurs s’installent, sortent leur thermos, et bien sûr, l’inconditionnel maté. Très vite la pampa sèche et plate s’étale derrière les fenêtres. La poussière rentre par les jointures. Une maniaque asperge régulièrement les sièges de bombe désodorisante. Bientôt chacun s’endort dans la position la moins inconfortable qu’il puisse trouver. Le jour se lève, rosé, éclairant de petites touffes d’herbes colorées à perte de vue, sans qu’il y ait âme qui vive. La végétation ne change pas tout au long des huit cent kilomètres de traversée.

San Carlos de Bariloche, situé en un lieu idyllique, mais certainement plus touristique que l’on ne croyait. A la gare, les sacs à dos de randonneurs se bousculent. La gare routière est submergée par les bus. Après avoir vaguement errés entre les échopes fermées pour le week-end à la recherche d’informations susceptibles de nous aider dans notre quête, nous allons nous prélasser au bord du lac, le soleil brulant notre décor Andin.

 joindre à nous, elle a donc quitté Kata, son troupeau et l'estancia arride de Pichi Leufu.
joindre à nous, elle a donc quitté Kata, son troupeau et l'estancia arride de Pichi Leufu.