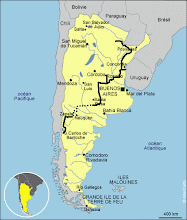Le lendemain, nous tentons de gagner coûte que coûte un endroit libre pour camper au bord du rio afin de fêter mes vingt-six ans. Nous trottons pour la première fois avec Mouloud en bât peu chargé. Rien ne bouge, il ne semble pas gêné, l'ensemble est bien solidarisé.Nos trois compères ont été courageux, trente kilomètres, la plus grosse étape jusqu'ici. Le pâturage est au rendez-vous. Pour nous, la fête est frugale mais bien rélle. Mousseux, Bailey's, crème de lait, pain, saucisson et un an de plus autour d'un feu. Une pluie fine vient arroser le tout.
SURPRIS EN PLEINE TOURMENTE.
 Sur le chemin, nous croisons quelques campos libres ainsi que des habitations aux populations d'avantage typées Mapuche. Nous décidons de faire un détour de quelques jours pour rendre visite à la communauté Aucapan. A la tombée de la nuit, nous arrivons au croisement de la réserve. Les maudites clôtures barricadent à nouveau des montagnes entières. Nous sommes contraints de planter la tente en bord de chemin et d'y attacher les chevaux. Le ciel est d'une étrange beauté, un cercle lumineux entoure la lune sur un ciel de feu. Nous ne pensions pas à un mauvais présage lorsqu'en pleine nuit le bruit de la pluie sur la toile n'est pas celui habituel. Au petit matin, dix centimètres de poudre blanche recouvre tout. L'hiver nous a finalement rattrapé. Pliant bagages, oubliant notre projet de détour, nous nous élançons dans
Sur le chemin, nous croisons quelques campos libres ainsi que des habitations aux populations d'avantage typées Mapuche. Nous décidons de faire un détour de quelques jours pour rendre visite à la communauté Aucapan. A la tombée de la nuit, nous arrivons au croisement de la réserve. Les maudites clôtures barricadent à nouveau des montagnes entières. Nous sommes contraints de planter la tente en bord de chemin et d'y attacher les chevaux. Le ciel est d'une étrange beauté, un cercle lumineux entoure la lune sur un ciel de feu. Nous ne pensions pas à un mauvais présage lorsqu'en pleine nuit le bruit de la pluie sur la toile n'est pas celui habituel. Au petit matin, dix centimètres de poudre blanche recouvre tout. L'hiver nous a finalement rattrapé. Pliant bagages, oubliant notre projet de détour, nous nous élançons dans  la tourmente pour quitter au plus vite les hauts plateaux. Le pire n'est pas de subir le vent ou les flocons, c'est la neige qui s'accumule entre les fers des chevaux. Nous avons beau curer les sabots toutes les dix minutes, d'énormes boules de glace reforment aussitôt, dures comme de la pierre faisant boiter et glisser les chevaux. Des hordes d'oiseaux au poitrails rouges nous suivent commes des dauphins à la proue d'un navire en dérive. Des troupeaux de chevaux s'enfuient au galop à notre approche.Les gens que nous croisons en voiture semblent nous prendre pour une curiosité, ou simplement pour des fous. Quatre heures de marche plus tard, les jambes coupées et les estomacs vides, nous marquons une pause. Les chevaux brouttent ce qu'ils peuvent pendant que nous préparons une grosse gamelle de riz que nous dévorerons. Les chiennes tremblent couchées dans la neige. Alors que des morceaux de glace tombent dans notre plat, nous prenons conscience que nous devons sortir de la cordillière rapidement, mais à quel rythme ?
la tourmente pour quitter au plus vite les hauts plateaux. Le pire n'est pas de subir le vent ou les flocons, c'est la neige qui s'accumule entre les fers des chevaux. Nous avons beau curer les sabots toutes les dix minutes, d'énormes boules de glace reforment aussitôt, dures comme de la pierre faisant boiter et glisser les chevaux. Des hordes d'oiseaux au poitrails rouges nous suivent commes des dauphins à la proue d'un navire en dérive. Des troupeaux de chevaux s'enfuient au galop à notre approche.Les gens que nous croisons en voiture semblent nous prendre pour une curiosité, ou simplement pour des fous. Quatre heures de marche plus tard, les jambes coupées et les estomacs vides, nous marquons une pause. Les chevaux brouttent ce qu'ils peuvent pendant que nous préparons une grosse gamelle de riz que nous dévorerons. Les chiennes tremblent couchées dans la neige. Alors que des morceaux de glace tombent dans notre plat, nous prenons conscience que nous devons sortir de la cordillière rapidement, mais à quel rythme ?Un peu plus loin, nous trouvons refuge dans une grande estancia à Pilolil. Les chevaux sont aux petits oignons. Lorsque Béatrice veut nous faire visiter les lieux, nous ne pouvons que rester comme deux pantins sur le
 paillasson devant la propreté des lieux. Une demeure luxueuse rien que pour deux voyageurs sales et trempés. L'estancia appartient en réalité à un riche propriétaire de Buenos Aires passionné par la chasse. Commerce lucratif, en plus de la traque du puma, ils élèvent aussi des cerfs qui seront lâchés pour la chasse dite sportive.
paillasson devant la propreté des lieux. Une demeure luxueuse rien que pour deux voyageurs sales et trempés. L'estancia appartient en réalité à un riche propriétaire de Buenos Aires passionné par la chasse. Commerce lucratif, en plus de la traque du puma, ils élèvent aussi des cerfs qui seront lâchés pour la chasse dite sportive.Deux jours de repos forcés ont fait fondre la neige. Après une crainte de fugue
 équine en bord de rio, une chaleureuse hospitalié chez Carlos, Americano et Paoli, nous franchissons un col qui n'en finit pas de grimper, Eprouvant mais une vue superbe sur la cordillière. Quelques sommets d'un blanc immaculé dominent fièrement des plateux désertiques. Des vestiges de neige nous rapellent de ne pas nous attarder dans le coin. Plus loin, de courageuses perruches batifolent dans les pins. Chapeau les filles, 'fait pas chaud !
équine en bord de rio, une chaleureuse hospitalié chez Carlos, Americano et Paoli, nous franchissons un col qui n'en finit pas de grimper, Eprouvant mais une vue superbe sur la cordillière. Quelques sommets d'un blanc immaculé dominent fièrement des plateux désertiques. Des vestiges de neige nous rapellent de ne pas nous attarder dans le coin. Plus loin, de courageuses perruches batifolent dans les pins. Chapeau les filles, 'fait pas chaud !A l'estancia de Cordero, pour la seconde fois consécutive, les chevaux sont en liberté dans un grand champ bien herbeux. Nous par contre, nous dormons à côté du groupe électrogène. Miguel, le fils de Cordero vient discuter avec nous jusqu'au moment du départ, souriant et plein d'humour.
 Un autre col nous fait passer juste à côté d'un impressionnant pic à plus de trois mille mètres d'altitude. Les chevaux peinent avec les bourrasques de vent. De l'autre côté, la végétation devient de plus en plus pauvre. Nous toquons à une ferme crasseuse mais hospitalière. Dans la nuit pendant que les vaches ne cessent de beugler dans le corral, nos chevaux en profitent pour casser une cloture branlante et s'enfuir... sur la route. Heureusement nous finissons par les apercevoir au loin la queue en panache. Ils reviennent à notre cri de ralliement qu'est le cri de l'avoine. Ils seraient presque mignons si Mouloud n'engrainait pas le groupe à faire les fous, empêchant Clio d'attraper Rita et Godofredo essayant de me jeter.
Un autre col nous fait passer juste à côté d'un impressionnant pic à plus de trois mille mètres d'altitude. Les chevaux peinent avec les bourrasques de vent. De l'autre côté, la végétation devient de plus en plus pauvre. Nous toquons à une ferme crasseuse mais hospitalière. Dans la nuit pendant que les vaches ne cessent de beugler dans le corral, nos chevaux en profitent pour casser une cloture branlante et s'enfuir... sur la route. Heureusement nous finissons par les apercevoir au loin la queue en panache. Ils reviennent à notre cri de ralliement qu'est le cri de l'avoine. Ils seraient presque mignons si Mouloud n'engrainait pas le groupe à faire les fous, empêchant Clio d'attraper Rita et Godofredo essayant de me jeter.CHALEUREUSE HOSPITALITE.
 En arrivant à Puente Picun Leufu, un jeune type est au milieu de rien. Marino nous invite à passer la nuit chez lui. Effectivement il y a une habitation en contrebas. Ce dernier nous y emmène en rentrant ses moutons pour les protéger des pumas. Il nous présente son frère Ernesto, découpant un estomac sourire en coin. Au premier abord, ils nous paraissent quelquent peu étranges au milieu de leur gourbis, mais très vite ils s'avèrent être d'une gentillesse irréprochable. Arrivent ensuiteVéro, la femme de Marino, et sa fille Ilda. Nous discutons d'un tas de choses, s'efforçant de satisfaire leur curiosité autour d'un énorme morceau de mouton, d'une salade de choux rafraichissante et du traditionnel maté. Non seulement ce repas nous remet d'aplomd, mais qu'il est agréable d'échanger les différences de modes de vie, des mentalités d'un pays à un autre et de leur fonctionnement. Pour eux, l'hiver est des plus rudes. Eloignés de tout sur des sols arides où ne poussent que pierres et piquants. Ils tirent leur unique revenu de leur bien maigre vente de bétail. Le bois de chauffage, ils doivent aller le chercher lo
En arrivant à Puente Picun Leufu, un jeune type est au milieu de rien. Marino nous invite à passer la nuit chez lui. Effectivement il y a une habitation en contrebas. Ce dernier nous y emmène en rentrant ses moutons pour les protéger des pumas. Il nous présente son frère Ernesto, découpant un estomac sourire en coin. Au premier abord, ils nous paraissent quelquent peu étranges au milieu de leur gourbis, mais très vite ils s'avèrent être d'une gentillesse irréprochable. Arrivent ensuiteVéro, la femme de Marino, et sa fille Ilda. Nous discutons d'un tas de choses, s'efforçant de satisfaire leur curiosité autour d'un énorme morceau de mouton, d'une salade de choux rafraichissante et du traditionnel maté. Non seulement ce repas nous remet d'aplomd, mais qu'il est agréable d'échanger les différences de modes de vie, des mentalités d'un pays à un autre et de leur fonctionnement. Pour eux, l'hiver est des plus rudes. Eloignés de tout sur des sols arides où ne poussent que pierres et piquants. Ils tirent leur unique revenu de leur bien maigre vente de bétail. Le bois de chauffage, ils doivent aller le chercher lo in dans la montagne à dos de mule. "De toute façon, les meilleures terres se sont de riches étrangers qui les achètent, signant des papiers qui n'existaient pas avant au détriment des gens qui y habitaient déjà sans le moindre papier en poche. Ensuite ils clôturent tout et y interdisent l'accès. Ils peuvent tuer tes animaux s'ils rentrent dans leur propriété. Que nous reste-t-il à nous et à notre bétail ?" dénonce Ernesto.
in dans la montagne à dos de mule. "De toute façon, les meilleures terres se sont de riches étrangers qui les achètent, signant des papiers qui n'existaient pas avant au détriment des gens qui y habitaient déjà sans le moindre papier en poche. Ensuite ils clôturent tout et y interdisent l'accès. Ils peuvent tuer tes animaux s'ils rentrent dans leur propriété. Que nous reste-t-il à nous et à notre bétail ?" dénonce Ernesto.Nous dormons dans un lit tordu, mais un lit quand même, à côté de la carcasse de celle que nous venons de déguster. La meilleure nuit depuis longtemps, bien au chaud. Au petit jour, tout le monde se réveille doucement au chant du coq, des dindons, des moutons et des vaches. Même Kali que nous croyions aphone fait désormais résoner de graves aboiements. Ernesto a déjà donné du foin et du mais à nos équipiers, de la viande au chiens. Nous partageons le maté devant la cour ensoleillée ornée de palans de bouchers et de seaux de sang. Ernesto et Marino n'osaient pas apposer leur écriture dans notre journal. Ils finissent par se lancer, tout le monde veut écrire dedans, même la petite Ilda y dessine sa minuscule main.
DESERT D'ALTITUDE.
 Les hauts plateaux qui nous attendent sont des plus désertiques, jonchés de pierres volcaniques, tout le reste pique. Nous plaignons les écoliers d'un pensionnat isolé. Le temps est à l'image des terres, hostile. La Lagune Blanche s'étend à l'horizon, cernée de montagnes, telles de cruelles dents acérés. Décors lunaire aux monts d'azote où l'hospitalité espérée ne sera pas. La gardienne du petit parc national hésite même à nous vendre une botte de foin. Pauvres canassons, ils dormirons attachés court à côté de la tente plantée sur les cailloux, à l'abris de l'unique mur aux environs. Un endroit de rêve. Rien de tel pour se remettre d'une turista que de s'exposer les fesses toutes les dix minutes au vent glacial à mille cinq cent mètres d'altitude. Le ciel menace de recouvrir tout de blanc, il ne manquerait plus que ça. Fausse appréhension pourtant, le soleil est de retour au matin, le vent se calme. Nous partons vers Zapala les poches vides de provisions, bientôt l'eau nous manque, ce midi ce sera donc polenta mi-cuite dans de la neige fondue après notre premier passage de clôture pour accéder à quelques touffes
Les hauts plateaux qui nous attendent sont des plus désertiques, jonchés de pierres volcaniques, tout le reste pique. Nous plaignons les écoliers d'un pensionnat isolé. Le temps est à l'image des terres, hostile. La Lagune Blanche s'étend à l'horizon, cernée de montagnes, telles de cruelles dents acérés. Décors lunaire aux monts d'azote où l'hospitalité espérée ne sera pas. La gardienne du petit parc national hésite même à nous vendre une botte de foin. Pauvres canassons, ils dormirons attachés court à côté de la tente plantée sur les cailloux, à l'abris de l'unique mur aux environs. Un endroit de rêve. Rien de tel pour se remettre d'une turista que de s'exposer les fesses toutes les dix minutes au vent glacial à mille cinq cent mètres d'altitude. Le ciel menace de recouvrir tout de blanc, il ne manquerait plus que ça. Fausse appréhension pourtant, le soleil est de retour au matin, le vent se calme. Nous partons vers Zapala les poches vides de provisions, bientôt l'eau nous manque, ce midi ce sera donc polenta mi-cuite dans de la neige fondue après notre premier passage de clôture pour accéder à quelques touffes  d'herbes. Finissant par haïr cette invention, nous déterrons un poteau et couchons l'ensemble pour y faire passer les chevaux. A l'approche de la nuit nous sommes encore à dix kilomètres de Zapala et toujours rien à l'horizon, pas d'herbe, pas d'eau, personne. Nous trottons pendant longtemps, le soleil disparaissant derrière la chaine de montagnes au loin, quelques nuages se teinant de rouge au dessus des immensités jaunies. Une image tout droit sortie d'un livre.
d'herbes. Finissant par haïr cette invention, nous déterrons un poteau et couchons l'ensemble pour y faire passer les chevaux. A l'approche de la nuit nous sommes encore à dix kilomètres de Zapala et toujours rien à l'horizon, pas d'herbe, pas d'eau, personne. Nous trottons pendant longtemps, le soleil disparaissant derrière la chaine de montagnes au loin, quelques nuages se teinant de rouge au dessus des immensités jaunies. Une image tout droit sortie d'un livre.Des arbres au loin, une estancia, nous tentons notre chance. Nous arrivons avec l'obscurité devant la maisonette de Frederico pour demander asile. Il accepte de mettre les chevaux dans le corral et nous dans le hangar. Nous discutons rapidement le soir, tout le monde est fatigué, il est temps de se reposer au côté des vaches et leur maudit mugissement répétitif. Demain, on mange un steak ! Nous restons une journée ou deux pour faire le plein de nourriture à Zapala, reposer les chevaux avant de s'attaquer au désert afin de gagner la pampa humide vers Santa Rosa.